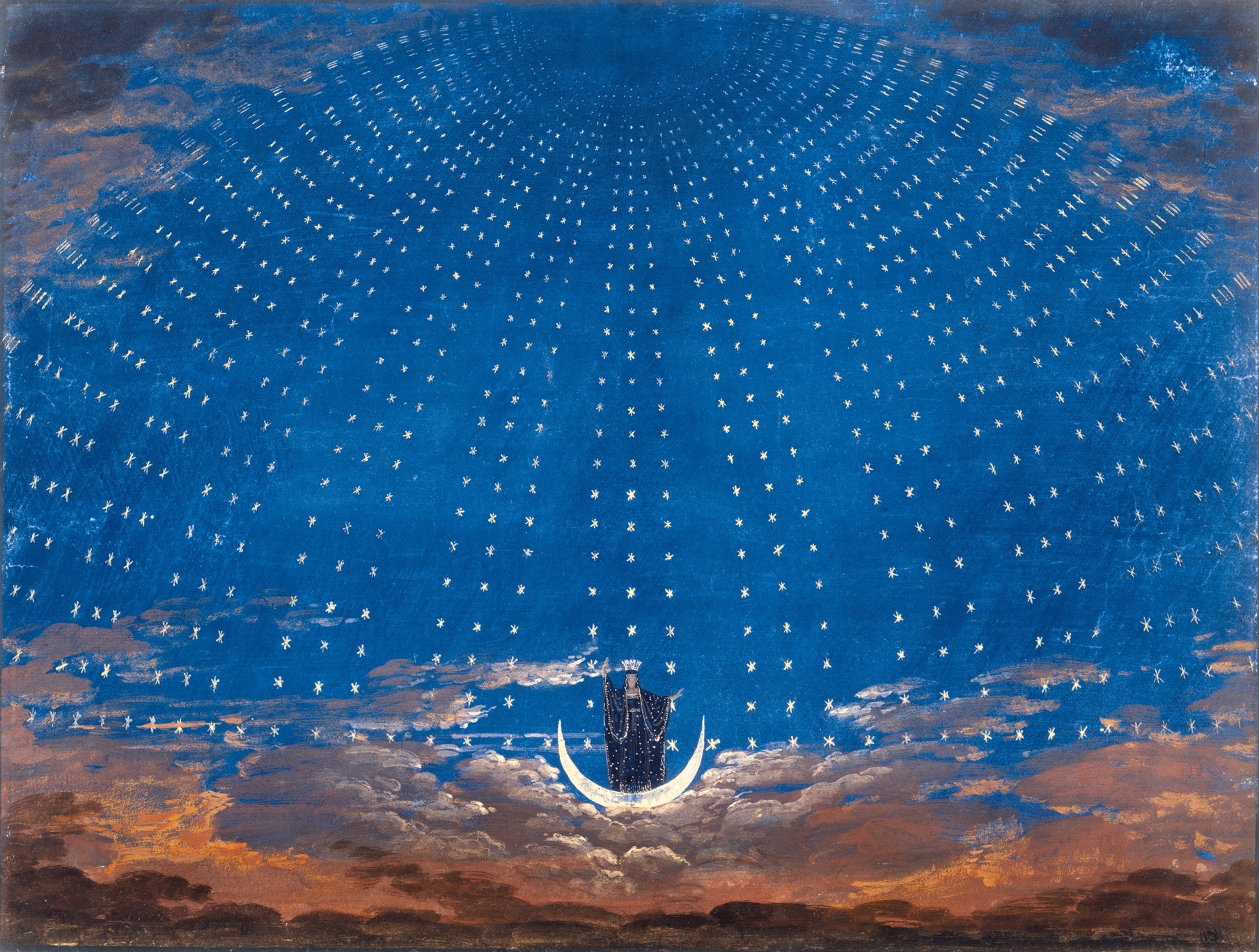Sensorialités, arts et esthétique 2025-2026 : Le savoir du végétal - perspectives critiques
Les arts contemporains expérimentent de nouvelles associations et hiérarchies entre les cinq sens, créent des synesthésies, reconfigurent et redéfinissent la relation de l’oeuvre à l’espace et au temps. Que ce soit dans le cadre de scénographies muséales, d’expositions ou de représentations théâtrales, les performances et les dispositifs immersifs ou participatifs vont de pair avec une implication corporelle et perceptuelle du spectateur : celui-ci ne se tient plus dans une contemplation distanciée mais se trouve environné par l’oeuvre, dont il fait l’expérience de manière en apparence immédiate. Pour l’esthétique, longtemps conçue comme une théorie du jugement, il s’agit dès lors de sortir du paradigme de la réception et de penser à nouveaux frais une agentivité des oeuvres d’art, que ce soit autour de la matérialité, ou de la « Bildwissenschaft » (science de l’image), qui a connu un fort impact en Allemagne, ou encore par le biais de notions comme l’atmosphère, la présence, la soma-esthétique, la contemplation entre autres.
Ce séminaire entend se fonder sur des mises en perspective historiques et remettre en particulier à l’honneur le paradigme sensoriel qui est à l’origine de l’esthétique allemande dans l’Aesthetica d’Alexander Gottlieb Baumgarten en 1750/58. Ce paradigme sensoriel a été souvent occulté dans les récits de la fondation de cette discipline qui n’y voyaient qu’une préfiguration imparfaite de l’esthétique kantienne. Or, le retour à ses origines historiques montre que, depuis le début, l’enjeu est double : il s’agit de réinventer l’art, mais aussi la sensibilité, et donc l’homme entier. Il s’agit par là-même d’envisager l’esthétique non pas (ou en tout cas pas seulement) comme une théorie du jugement mais (aussi) d’abord comme un type de connaissance reposant sur les sens.
Germanistes travaillant sur le théâtre et les études visuelles, l’art des jardins et les transferts culturels, l’histoire religieuse et les interactions entre art, culture et religion, nous proposons donc dans ce séminaire, d’une part, de réinterpréter la tradition esthétique allemande afin de mettre en évidence les articulations qu’elle convoque entre corps, matières et médias, et, d’autre part, d’historiciser de la sorte les évolutions contemporaines, tout en explorant et en analysant ces dernières. Notre séminaire souhaite par conséquent s’ouvrir à d’autres espaces, arts et esthétiques, tout en s’ancrant dans l’aire culturelle germanophone, étant donné l’importance historique de la pensée esthétique allemande.
Thématique 2025-2026 : Le savoir du végétal - perspectives critiques
Après s’être attaché lors des années passées à explorer les relations entre les sens, les notions d’atmosphère et d’empathie, notre séminaire interrogera à partir de 2026 les liens entre sensorialités, arts et esthétiques et le vivant non-humain, en particulier à travers la question du savoir du végétal, envisagée de façon critique. Ces dernières années en effet, dans un contexte global de bouleversement climatique et de mise en danger de la biodiversité les Plant Studies occupent, au sein des humanités environnementales, une place croissante, et bénéficient d’un intérêt toujours plus vif dont attestent des ouvrages « grand public » ou de vulgarisation comme ceux de Peter Wohlleben (Das geheime Leben der Bäume, 2015, traduction française 2017) ou de Stefano Mancuso et Alessandra Viola (Verde Brillante – sensibilità et intelligenza del mondo vegetale, 2015, traductions allemande et française 2015, 2020) ou celui, plus philosophique, d’Emanuele Coccia (La vie des plantes, 2016, traductions italienne et allemande 2018) – ou encore la création du Literary and Cultural Plant Studies Network (LCPSN) en 2018. Les plantes, ainsi placées au centre de l’attention, sont décrites comme des êtres dotés de sens inconnus et d’une agentivité spécifique. En essayant de concilier l’apport des botanistes et des philosophes, il s’agira donc de déporter notre regard vers le végétal et d’interroger la place de ce dernier dans les arts, la littérature ou l’histoire culturelle.
Des chercheurs et éventuellement des artistes de différentes disciplines et de divers horizons interviendront dans le cadre des cinq séances prévues à partir de janvier 2026 (à chaque fois le vendredi de 14h30 à 16h30). Chaque séance se déroulera en deux temps : lors de la première partie, l’invité (voire deux invités) présentera ses recherches en cours ou bien un ouvrage déjà publié ou encore un extrait de texte théorique ou un extrait d’oeuvre (précédemment communiqué à l’ensemble des participants du séminaire) ; une discussion commune s’ensuivra lors de la deuxième partie de la séance.
Programme prévisionnel des séances :
Vendredi 9 janvier 2026 (14h30-16h30) :
Intervenants : Anne-Marie Pailhès et Jean-Michel Pouget (Univ. Paris-Nanterre)
Université Sorbonne Nouvelle, Maison de la Recherche USN, salle du Conseil
Vendredi 20 février 2026 (14h30-16h30)
Intervenante : en attente de confirmation
Université Sorbonne Nouvelle, Maison de la Recherche USN, salle du Conseil
Vendredi 20 mars 2026 (14h30-16h30)
Intervenante : Urte Stobbe (Univ. Köln))
Université Paris 8, salle A2-215 (bâtiment passerelle vers la MdR)
Vendredi 10 avril 2026 (14h30-16h30)
Intervenant : En attente
Université Sorbonne Nouvelle, Maison de la Recherche USN, salle du Conseil
Vendredi 29 mai 2026 (14h30-16h30)
Intervenante : Eliane Beaufils (univ. paris VIII)
Université Paris Nanterre, Salle de séminaire 2, Bâtiment Weber
Contacts : florence.baillet@sorbonne-nouvelle.fr, sylvielegrandticchi@wanadoo.fr, marie-ange.maillet@univ-paris8.fr